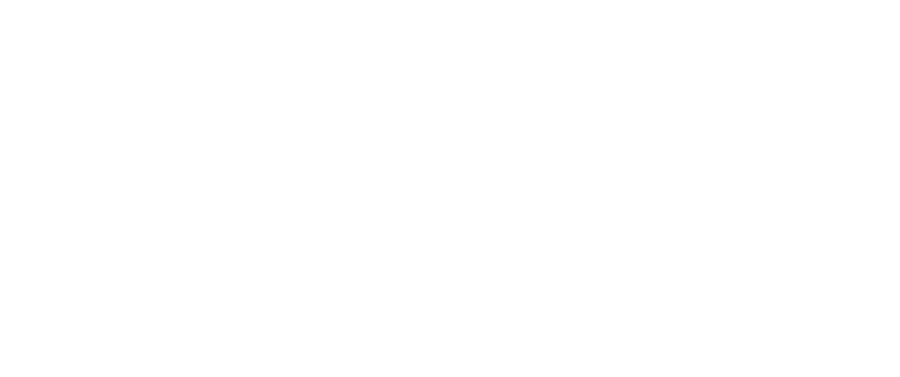La porte d’entrée d’un foyer
série : Bienvenue à la maison | Texte biblique : Livre de Ruth
Le livre de Ruth parle du départ de la maison et du retour. Pour que la veuve Ruth puisse s’installer en Israël, elle avait besoin d’un libérateur. Boaz a assumé cette fonction. Elle a ainsi obtenu une base de vie et un espoir éternel. Jésus est notre rédempteur ; lui aussi nous permet de nous établir dans la maison de Dieu.
La bénédiction de Noemi G. aujourd’hui est une occasion suffisante pour nous pencher sur la Naomi de la Bible dans le livre de Ruth. C’est l’histoire d’un retour à la maison. Mais pour l’instant, elle est partie à l’étranger.
Un pain dur à l’étranger
Naomi vivait avec son mari Elimelech et ses deux fils Machlon et Kiljon à Bethléem, ce qui signifie «maison de pain». Mais une famine s’abattit sur le pays. Le pain se faisait rare à Brothausen. C’est pourquoi toute la famille de Naomi et d’Elimélec s’est installée à Moab, une région située au sud d’Israël. À première vue, nous disons : «C’est compréhensible !«Mais nous devons regarder de près quelle est cette famille qui se rend à Moab. C’est frappant parce qu’on ne va pas vraiment à Moab, surtout pas pour y chercher son pain. Il n’y a pas de pain ni d’eau pour les étrangers à Moab, c’est l’expérience d’Israël durant sa traversée du désert.
Qui recevra du pain et de l’eau à Moab, où l’on ne reçoit volontairement ni l’un ni l’autre ? Sans doute celui qui a quelque chose à donner en échange. La famille de Noomi apporte quelque chose qui lui permet d’avoir accès au pain et à l’eau : de l’argent. Elle dit elle-même : «J’ai émigré riche et prospère, et le Seigneur me laisse rentrer chez moi les mains vides.» (Ruth 1,21). Cet argent ne leur ouvre pas seulement l’accès à la nourriture, mais aussi à la société. Seuls les riches pouvaient se marier au pays de Moab. Ses deux garçons épousent des femmes moabites : Orpa et Ruth. Pourquoi les riches doivent-ils fuir vers Moab si le pain est rare ? On peut supposer qu’ils veulent ainsi préserver leurs richesses. Ils ne fuient pas la faim qui veut entrer chez eux, mais le mendiant qui veut s’asseoir à leur table. Ils refusent la solidarité.
Mais Moab devient une impasse. Ils y mangent «du pain dur». Comme le mari et les deux fils de Naomi meurent, elle reste seule. Elle devient une femme solitaire et amèreComme elle l’exprimera elle-même plus tard, à son retour à Bethléem : «.Ne m’appelez plus Naomi, appelez-moi Mara (= amertume), car le Tout-Puissant m’a rendu la vie amère.» (1,20). Les veuves de l’époque étaient hors-la-loi, dans un état d’absence totale de droits et de protection. Ce n’est qu’en trouvant un nouveau foyer et en donnant naissance à des enfants qu’elles pourraient échapper au piège de la pauvreté.
Israël est le peuple de Dieu. Au sens figuré, la famille a quitté le Dieu d’Israël pour un pays où trônait l’égoïsme et où les habitants sacrifiaient même leurs enfants aux idoles. Moab signifie «du père» et témoigne de son origine. C’était à l’époque de la destruction de Sodome et Gomorrhe (Genèse 19). Lot, le neveu d’Abraham, vivait avec ses deux filles dans une grotte en haut des montagnes. Dans cet isolement, loin d’éventuels maris, les deux femmes échafaudèrent un plan pour avoir des enfants. Elles firent boire Lot et couchèrent avec lui. C’est de cette aventure que naquit l’enfant incestueux Moab. Ce crime a dès lors plané comme une ombre sur les Moabites – une blessure ouverte. Quelque chose de compromettant pesait sur ce peuple.
C’est dans ce pays qu’Elimelech s’est installé avec sa famille pour y mettre ses richesses à l’abri. Son motif était l’amour de l’argent, qui, comme chacun sait, est la racine de tous les maux. (1 Timothée 6.10). Et d’une certaine manière, le pain ne les nourrissait pas non plus de la même manière qu’à Bethléem. Dans la parabole des fils prodigues, le fils cadet a également quitté la maison pour s’acheter une vie épanouie. Sa tentative a échoué lamentablement et il a fini affamé avec les porcs. Jésus explique ce principe : «Car celui qui essaie de préserver sa vie la perdra» (Marc 8,35). C’est exactement ce qu’a vécu la famille d’Elimélec et de Naomi. Ils ont suivi leur propre chemin et se sont éloignés de la «maison du pain» parce qu’ils pensaient que l’herbe était plus verte de l’autre côté de la clôture. Beaucoup de gens pensent ainsi. Ils pensent qu’une vie auprès de Dieu présente des inconvénients et ne nourrit pas assez. Dans leur quête d’une vie épanouie, ils cherchent ailleurs. Malheureusement, cette richesse trompeuse nous laisse finalement sur notre faim. Notre faim de sens, de sécurité, d’amour et d’appartenance n’est satisfaite qu’auprès de Dieu.
Il est également typique que Naomi, en pleine crise, rejette la faute sur Dieu : «Ne m’appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m’a rendu la vie amère. J’ai émigré riche et prospère et le Seigneur me laisse rentrer chez moi les mains vides. Pourquoi m’appeler Naomi, alors que le Seigneur m’a fait tant souffrir et que le Tout-Puissant a fait venir sur moi tant de malheurs ?» (1,20f). En prenant nos distances avec Dieu, nous nous retrouvons tous les mains vides. Ne poursuivons-nous pas souvent aussi nos propres voies vers le bonheur et, lorsque nous sommes en crise, ne rejetons-nous pas la faute sur Dieu ? C’est ce qu’on appelle le déisme égocentrique : c’est moi qui crée ma vie. Je décide de ce qui est bien ou mal pour moi et Dieu m’aide à le faire. Dieu est mon sauveur personnel et ne me décevra jamais. Quelle erreur !
Retour à la maison
Naomi se met donc en route pour retourner à Bethléem, auprès de ceux qu’elle a abandonnés – à l’époque où elle était encore riche. Elle veut d’abord se débarrasser de ses belles-filles et les renvoie dans leurs familles. L’amertume cherche la solitude. Celui qui est amer sait qu’il est insupportable. Noomi dit : «Non, mes filles, faites demi-tour, car je suis trop vieille pour me marier à nouveau. Et même si je disais : «J’ai encore de l’espoir», oui, même si je m’unissais à un homme cette nuit encore et que j’avais des fils, à quoi cela servirait-il ? Attendriez-vous qu’ils soient adultes ? Vous enfermeriez-vous si longtemps et renonceriez-vous à tout autre mariage ? Non, ne me suivez pas, mes filles ! Mon amer chagrin est encore plus lourd pour moi que pour vous, car le Seigneur lui-même l’a fait venir sur moi» (1,12f).
Naomi évoque le mariage par alliance. Lorsqu’un homme marié décède et ne laisse pas d’enfants, le parent le plus proche a l’obligation de prendre la veuve pour épouse. Le premier fils qu’elle met au monde est alors considéré comme un descendant du frère décédé, afin que son nom soit conservé en Israël. Le problème, c’est qu’un tel frère n’était pas encore né et que Naomi n’avait plus de mari. Le seul espoir d’avenir pour ses belles-filles était qu’elles se trouvent un mari moabite.
Orpa, qui signifie «derrière la tête», saute. Naomi ne la voit plus que de dos. Mais Ruth refuse purement et simplement de quitter Naomi. «Mais Ruth répondit : «Ne me demande pas de te quitter et de revenir sur mes pas. Là où tu iras, j’irai aussi, et là où tu vivras, je vivrai aussi. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et je serai enterré. Que l’Éternel me punisse si je permets que quoi que ce soit d’autre que la mort nous sépare !» » (Ruth 1,16f).
Le texte hébreu est empreint de la violence avec laquelle il est prononcé. Les phrases sont courtes et concises : «Ton peuple – mon peuple, ton Dieu – mon Dieu !La traduction de Ruth est «l’amie, la compagne». Et Ruth devient ce que son nom évoque : la compagne de Naomi. En même temps, les phrases concises de Ruth contiennent une profession de foi claire en l’unique Dieu d’Israël.
Appartenant à la maison
Or, Naomi déménage avec sa belle-fille Ruth à Brothausen, et ce, judicieusement, au moment de la récolte de l’orge. La pénurie de pain est terminée. Ruth doit maintenant subvenir à ses besoins. Dans l’ancien Israël, les personnes socialement défavorisées, comme les veuves, avaient le droit de passer derrière les moissonneurs lors de la moisson pour ramasser les épis restants. Ruth a fait cela dans le champ de Boaz, un parent d’Elimélek. Boaz était très bien disposé à son égard, il assurait sa sécurité, lui donnait des collations et faisait en sorte que les moissonneurs laissent plus d’épis.
«Où as-tu ramassé tout ce blé aujourd’hui ?», s’écria Naomi. […] Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Elle lui dit : «L’homme dans le champ duquel j’étais aujourd’hui s’appelle Boaz». «Que le Seigneur, qui n’a retiré sa grâce ni aux vivants ni aux morts, le bénisse», dit Naomi à sa belle-fille. «Cet homme est l’un de nos plus proches parents (hébreu : qarob), l’un des rachetés (hébreu : goel) de notre famille.» (2,19f).
La première chose qui frappe, c’est que Naomi retrouve la foi. «Le Seigneur n’a pas retiré sa grâce.«De plus, Naomi a besoin de deux expressions qui déterminent durablement la suite des événements. Elle dit que Boaz est un qarob (parent) et aussi un goel (solution). Le Löser est le parent le plus proche qui doit racheter les terres des hommes appauvris ou décédés sans enfants. Dans ce dernier cas, le racheteur doit tenter, par le biais d’un mariage avec la veuve, de procurer un héritier à la propriété en lieu et place du défunt. La situation était la suivante : Boaz était le deuxième rachetant. Il y avait encore un parent proche qui avait le «droit de rachat anticipé». Celui-ci aurait certes volontiers racheté la terre d’Elimélek, mais il ne voulait pas épouser Ruth, la veuve moabite (4,1ss).
«Boaz dit alors aux anciens et à tous les gens présents : «Vous êtes témoins que j’ai acheté aujourd’hui à Naomi tous les biens d’Élimélec, de Kiljon et de Makhlon. En même temps que les terres, j’ai aussi acquis Ruth, la veuve moabite de Machlon. Elle deviendra ma femme afin que le défunt ait un héritier qui perpétuera son nom. Ainsi, son nom ne disparaîtra pas dans le cercle de ses proches et parmi les citoyens de la ville. Vous en êtes tous témoins aujourd’hui».» (4,9f).
Boaz est devenu le libérateur de Naomi. La veuve hors-la-loi issue d’un peuple né de l’inceste a trouvé une nouvelle patrie. C’est Boaz, le rédempteur, qui a ouvert la porte à leur nouveau foyer au sein du peuple de Dieu. Ce n’est pas par hasard que le terme «libérateur» a cette grande ressemblance avec le mot «rédempteur». Dieu se présente à Moïse comme celui qui va délivrer Israël de la main des Égyptiens (Exode 6,6). Dans Esaïe 41,14, on trouve également ce mot goël en hébreu : «[…] Ne crains rien, je te sauverai, tu as ma parole. Ton sauveur est le Saint d’Israël.» En fin de compte, Dieu nous rachète tous par Jésus-Christ. Il ouvre la porte au Dieu unique, le Père céleste. Grâce à Jésus, nous avons accès à la maison de Dieu. Cette signification primordiale et prophétique de ce petit mot goël est déjà exprimée dans l’Ancien Testament : «Mais pour Sion et ceux de Jacob qui se détournent de leur péché, il vient comme sauveur. Sur ce, le Seigneur donne sa parole» (Esaïe 59.20).
Jésus est notre Sauveur. Grâce à lui, qui nous ouvre la porte, nous recevons un foyer dans la maison de Dieu. En étant chez nous, nous ne sommes plus hors-la-loi, mais nous obtenons la sécurité, la qualité de vie et l’avenir éternel. Notre nom ne sera jamais perdu. De plus, nous sommes libérés des ombres sombres, qu’elles soient dues à l’inceste ou à autre chose. La maison de Dieu est aussi la maison du pain (Bethléem). Il y a toujours une récolte d’orge et donc suffisamment de pain. Jésus, descendant de Ruth, dit de lui-même : » ?Je suis le pain de la vie» (Jean 6,48). Il est venu nous «offrir la vie dans toute sa plénitude» (Jean 10,10).
Questions possibles pour les petits groupes
Lire le texte biblique : Ruth 1 et 4,1–12
- Que représente Bethléem et que représente Moab dans l’histoire ? Pourquoi la famille d’Elimelech/Noomi ne pouvait-elle pas être heureuse à Moab ?
- Comment fonctionnait l’institution du rédempteur dans l’ancien Israël ? Dans quelle mesure ouvrait-elle la porte à une nouvelle patrie ?
- Quels sont les parallèles avec Jésus ?
- Comment la situation de Ruth a‑t-elle changé après la rédemption de Boaz ?